Tous les jours, je vais voir sur Google Maps si la tectonique des plaques n’a pas joué en ma faveur nuitamment, rapprochant de ma porte les terrils, les lapins, les ruisseaux. Non.
Je me dis qu’au pire, je peux aller près de la faculté des sciences Jean Perrin (les anciens Grands Bureaux des Mines) contempler cette fresque pastorale que j’aime tant, au point que je fantasme parfois de démonter le mur (il est long d’une centaine de mètres) pour le mettre en lieu sûr avant qu’un urbaniste ne le livre aux graffeurs à la mode et que l’on y trouve les mêmes BD murales aux couleurs primaires et régressives que sous le pont Césarine.

La première fois que je la lui ai montrée, M. s’est étonnée ; elle a voulu savoir ce que je trouvais à cette fresque. J’ai parlé du côté suranné, qui me touche infiniment plus que le graff contemporain. Et quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu’il y avait autre chose, et qu’elle me rappelle une toile accrochée dans la salle à manger de mes grands-parents.
Ou peut-être les urbanistes ont-ils d’autres priorités, peut-être, si je survis au Covid-19, verrai-je ces paysages de béton s’éroder naturellement comme ils le font sur le trottoir d’en face.

J’essaie d’imaginer les lieux qui me manquent désertés par les humains ; comme ils doivent être paisibles, comme les animaux doivent être détendus, comme la musique du vent dans les arbres doit être envoûtante – dans mon jardin, déjà, le bruissement de Carol-Anne évoque plus que jamais le flux et le reflux du Pacifique, en l’absence de tout bruit parasite – au point que je choisis spontanément d’écouter Sunergy de Kaitlyn Aurelia Smith et Suzanne Ciani, en remontant à mon bureau après le déjeuner : je me rends compte au moment où j’écris ces lignes que, ce faisant, je prolonge inconsciemment l’expérience du jardin pacifique.
C’est une consolation pour moi que d’imaginer la nature heureuse en notre absence, mais soudain ma connaissance de l’espèce humaine me fait tressaillir, et je suis prête à parier que des immondices profitent de la circonstance pour chasser en toute impunité, les forces de l’ordre étant occupées ailleurs. J’espère de tout cœur être parano.
Aujourd’hui, j’ai décidé de boycotter le stade Léo Lagrange : ras le bol.
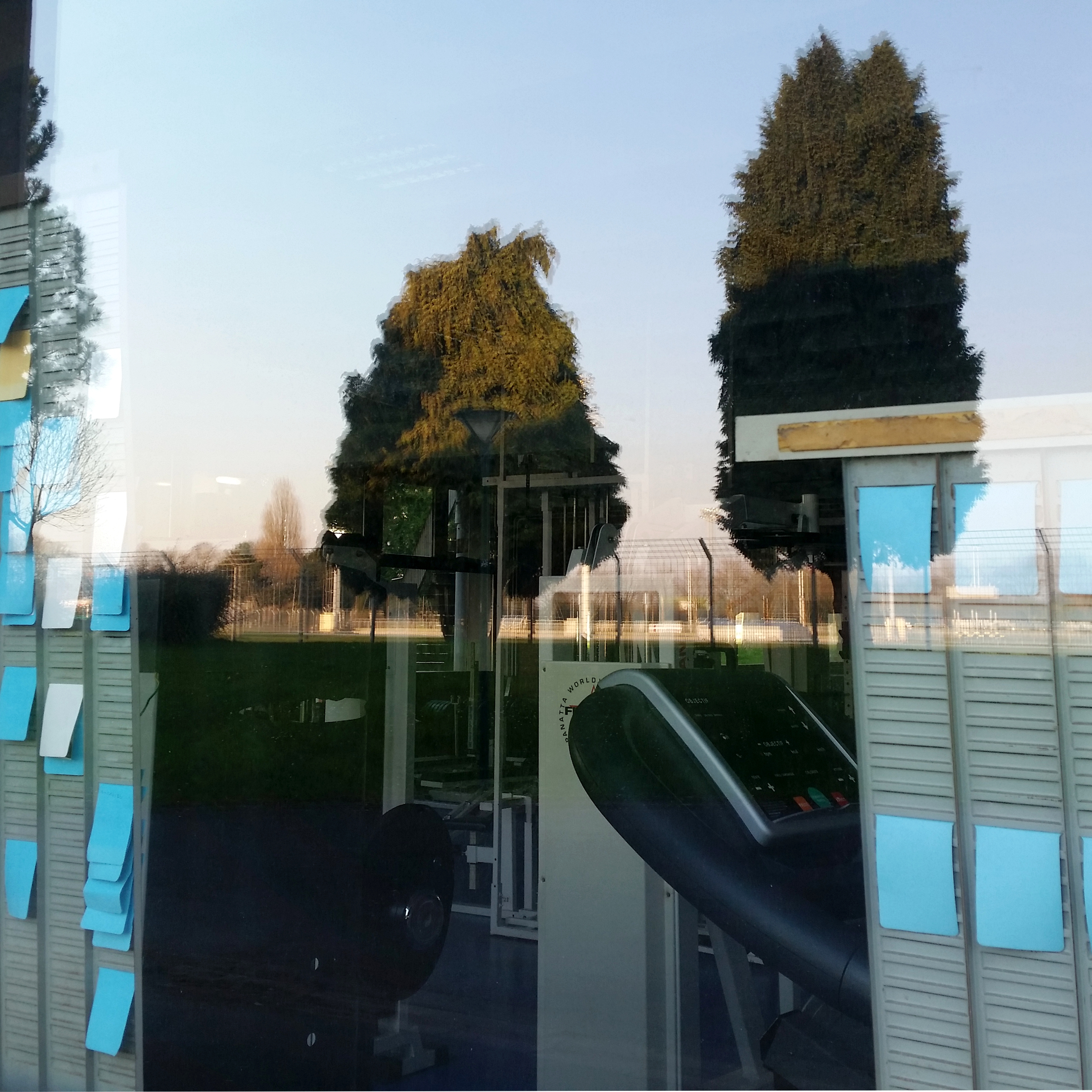
J’ai trouvé ! C’est légal, si l’on considère que l’on parle d’un kilomètre à vol d’oiseau. Ni terril ni ruisseau ici mais zéro humain non plus, c’est déjà bien, et quand j’ai surgi dans la clairière, des lapins ont bondi de toutes parts. J’en aurais pleuré de gratitude si je n’évitais tout contexte qui m’oblige à me moucher (trop douloureux).

Quand on traverse Lens déserte, on pourrait croire que ses habitants respectent les consignes



(Je n’aurais jamais pensé voir un jour le pont Césarine sans circulation.)
mais manifestement, la vie continue de battre son plein quand la police et moi avons le dos tourné : on semble toujours avoir hot fun dans ces rues que je vois pourtant toujours désertes

et on poursuit les orgies en plein air (l’avenir du plastique n’est pas en danger),

même si des poètes invitent à rester chez soi – ils ont un petit problème avec le doublement de consonnes mais l’esentiel, c’est le contennu.

Avant le confinement, j’étais fière de ne plus boire qu’un verre de temps en temps, de pouvoir enchaîner quatre soirées infusion sans frustration – mieux, sans même y penser. Depuis le confinement, l’apéro est devenu un rassurant repère dans un quotidien disloqué. Il faudra reprendre le sevrage à zéro, quand le confinement sera terminé.
Ce soir, alors que sonne l’heure de déboucher le vin, la journée change brutalement de thématique. Quelles étaient les probabilités pour que, sur un foyer de cinq confinés, à deux jours d’écart, trois personnes soient amenées à passer des heures dans un service d’urgences pour des raisons extérieures à la pandémie ? Pour que des pompiers passent une vingtaine de minutes dans mon salon avant d’emmener dans leur camion une maman et son lycéen pâmé, faire des examens complémentaires dans un hôpital en temps de guerre (avec porte-avions) ? Par chance, le coronavirus est plus discipliné que ne le fut en son temps le nuage de Tchernobyl, me dit-on, et ne se glisse pas subrepticement dans l’aile du bâtiment qui ne lui est pas dévolue. Si nous sortons de cette aventure indemnes et en bons termes, mes co-confinés et moi, nous pourrons en rire : Quelle super pioche !
Et je n’ai presque plus de Temesta.